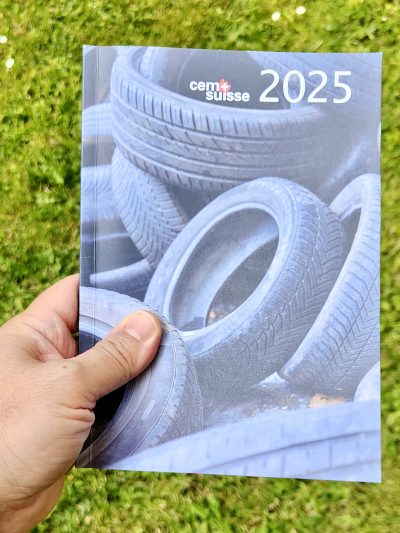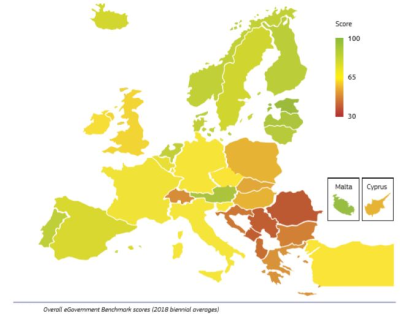Le 13 décembre dernier, le Conseil fédéral prenait
connaissance des résultats de l’analyse d’efficacité de la tarification de la
mobilité, autrement dit du concept de road
pricing. Les enjeux et objectifs liés à la mobilité sont multiples : réduire
les pics d’affluence, assurer le financement des infrastructures routières, ou
encore promouvoir l’usage des transports en commun. Le futur projet du
gouvernement a l’ambition d’y répondre et c’est l’occasion de disséquer
les enjeux de la mobilité de demain.
Revoir le financement de nos routes
Devenus interdépendants, route et rail ne s’opposent plus
En 2020, il ne s’agit plus d’opposer automobilistes et
usagers des transports publics : l’heure est à la multimodalité. Si des
transports publics efficaces convainquent davantage de pendulaires de les
utiliser, c’est autant de véhicules en moins sur nos axes autoroutiers
bouchonnés matin et soir, en provenance du Valais et en direction de Berne, de
Lausanne ou de Genève. En fait, l’introduction de mesures incitatives ciblées
en faveur des transports en commun a sans doute un résultat nettement plus
efficace sur le désengorgement de nos axes routiers surchargés que la
construction d’une troisième ou d’une quatrième voie autoroutière. Encourager
l’usage des transports en commun sert donc tout à la fois les intérêts du rail
et de la route, transports en communs ou individuels.
Le financement de nos axes routiers est dual : tant
l’usager que le contribuable participent. Pour ce qui est de l’usager, sa contribution
se fait principalement par l’impôt sur les huiles minérales, autrement dit par
la fiscalisation du litre d’essence et de diesel. Mais l’usager contribue
également au financement de l’infrastructure routière via la redevance pour
l’utilisation des routes nationales (la vignette autoroutière), l’impôt
cantonal sur les automobiles et enfin la redevance sur les véhicules
électriques. Le reste étant financé par le pot commun, c’est-à-dire le
contribuable des communes, des cantons et de la Confédération. Cependant, la
principale contribution de l’automobiliste demeure avant tout celle prélevée
sur sa note lorsqu’il fait le plein : sur un litre payé 1,60 fr., seuls 75
centimes tout compris rémunèrent la chaîne de production et de distribution
complète, du foreur de pétrole brut au salaire du vendeur de la station-service.
Le reste de la note se compose principalement de l’impôt et de la surtaxe sur
les huiles minérales.

Composition du prix d’un litre
d’essence à 1,60 fr. (source : Avenergy Suisse, Zurich, 2018)
Avec ses 1894 km de tronçons, la Suisse connait une densité autoroutière
parmi les plus élevées au monde
La croissance fulgurante du nombre de véhicules électriques
ou à propulsion alternative (hydrogène par exemple) va très vite assécher les
recettes de l’impôt sur les huiles minérales, si bien que le financement à
terme de notre exceptionnelle infrastructure autoroutière n’est plus assuré.
Car, oui, notre infrastructure autoroutière est exceptionnelle : avec un
réseau prévu de 1’894 km d’autoroutes (Haut-Valais compris) pour une superficie
de 41’290 km2, c’est l’une des densités autoroutières les plus élevées au
monde.
Réseau des routes nationales suisses
(source : OFROU, 2019)
Un enjeu évident de la mobilité multimodale passe par la
promotion des transports en commun. Trop souvent, le débat a malheureusement
crispé les fronts entre partisans et opposants de la voiture. Un automobiliste
n’a parfois pas le choix. L’amélioration qualitative de l’offre en transports
en commun a un double effet bénéfique : d’une part, l’automobiliste qui le
souhaite accède à une alternative ; d’autre part, le réseau routier est
allégé d’autant et le trafic est fluidifié pour les autres usagers de la route.
Bien sûr, il n’est pas possible aujourd’hui d’offrir une
desserte en transports publics attractive pour un trajet pendulaire entre
Evolène et Corsier-sur-Vevey, aussi facilement qu’entre Montreux et Sion. Il
n’empêche, en moyenne nationale les kilomètres parcourus avec le rail ont bondi
de 50% entre 1995 et 2015, contre un peu plus de 30% pour les déplacements en
voiture. La part de transports en commun pour nos déplacements est donc croissante,
ce qui est en soit réjouissant : cela signifie que l’offre est attractive,
l’essor du rail et le succès des abonnements des CFF en témoigne. Soit dit en
passant, c’est en revanche dans le domaine du transport des marchandises que le
rail recule face à la route : le transport sur rail a stagné depuis 1995
alors qu’il a bondi de 30% sur route. C’est là aussi que réside l’un des enjeux
de la politique des transports.
Distances parcourues pour le
transport par la route et le rail (source : OFS, 2017)
Moins d’un kilomètre sur quatre est parcouru pour se rendre au travail
L’attractivité des transports publics passe aussi par une
approche plus originale, ciblée sur des besoins identifiés. Par exemple, depuis
cet hiver, les skieurs peuvent embarquer dans le train à la gare de Cornavin,
au centre de Genève, pour rejoindre au Châble le départ de la télécabine en
direction du domaine skiable de Verbier et cela, sans aucun changement de train
et en évitant certains arrêts régionaux moins importants. Pour preuve que cela
répond à une attente, ces trains destinés au tourisme hivernal ne désemplissent
pas les weekends de ce début de saison 2019-2020. Il est un fait méconnu :
nous nous déplaçons d’abord pour nos loisirs, et très nettement. Bien davantage
que pour nous rendre à notre travail. Les loisirs et les activités de tourisme
comptent donc de manière prépondérante dans les enjeux de la mobilité de demain.
Distance journalière moyenne parcourue
par personne en Suisse (source : OFS, 2017)
En réalité, il existe de nombreuses façons d’améliorer
qualitativement l’offre en transports publics, simplement en nous efforçant de
comprendre les scénarios d’utilisation, comme celui qui achemine les skieurs
des villes, de Genève à Vevey sur les pistes valaisannes. Et cette approche de
l’amélioration de l’attractivité de l’offre est incontestablement plus réfléchie
et aboutie que celle qui consiste à taxer la route pour obliger les gens à se
rabattre sur le rail.
Dans un système libéral, il est juste de payer ce que nous utilisons
Dans ce contexte, le financement de nos infrastructures
routières doit être repensé. Dans un système véritablement libéral, il est finalement
très juste que chacun paie ce qu’il utilise vraiment. Sachant que le réseau
autoroutier est financé d’abord par l’impôt sur les huiles minérales, un
véhicule à propulsion électrique utilise le même réseau autoroutier mais ne le
finance pas, ce qui est un non-sens. S’il est compréhensible d’avoir favorisé
fiscalement le créneau de véhicules au bilan carbone plus favorable, la
solution n’est cependant pas tenable et nécessite d’être revue. Un financement
viable à terme de nos infrastructures doit se baser sur l’utilisation effective
de celles-ci.
En ce sens, la vision du Conseil fédéral est juste :
les impôts et redevances actuelles, dont l’impôt sur les huiles minérales
pourraient disparaître au profit d’un road
pricing plus simple où chacun paie pour les infrastructures qu’il a
sollicitées et la distance qu’il a réellement parcourue. Evidemment la
facturation devra être automatisée et couplée à la détection automatique des
véhicules qui s’engagent sur le réseau autoroutier en répondant également aux
impératifs liés à la protection des données personnelles. In fine, le système
mis en place devra être neutre au niveau de la charge fiscale, transparent
envers l’usager et le plus simple possible, avec en ligne de mire le triple
objectif de réduire les pics d’affluence, d’assurer le financement des
infrastructures routières et aussi de promouvoir l’usage des transports en
commun.
Repenser la voiture individuelle
Un véhicule est avant tout un moyen de se déplacer du point
A au point B. Le rapport quasiment affectif que nous entretenons parfois avec
notre voiture se fonde sur ce qu’il a su apporter à notre société et
principalement aux deux générations qui nous ont précédés : une certaine
idée de la liberté et de l’indépendance. C’est évidemment vrai et ça demeurera
vrai dans un système où les alternatives sont inexistantes ou pour le moins non
efficientes. Il n’empêche, les cas d’utilisation d’un véhicule sont aujourd’hui
variés et la mobilité doit être repensée en fonction. Si par hypothèse, une
alternative efficace en transports publics devait exister pour nos trajets
quotidiens, nous serions nombreux à la choisir. Tout l’enjeu réside
essentiellement dans la couverture des premiers et des derniers kilomètres d’un
long trajet, c’est-à-dire le trajet qui sépare notre domicile de la première
gare et celui sépare la dernière gare de notre destination, que cela soit un
lieu de travail ou une destination de loisirs. L’essentiel d’un long parcours
devrait idéalement pouvoir être couvert par une liaison ville à ville en train.
Les autoroutes en Suisse, c’est 65 heures quotidiennes d’embouteillage, 24’000
heures par an
L’équation est extrêmement simple pour un scénario de centre-ville
à centre-ville. Elle l’est nettement moins lorsqu’on habite en montagne, dans
un village de plaine ou même à la périphérie de nos villes valaisannes et qu’on
doit se rendre à un endroit excentré par rapport aux gares principales du
réseau CFF. Partir de chez soi avec sa voiture, parquer en ville (et payer un
abonnement de stationnement), marcher encore jusqu’à la gare, prendre le train
pour rejoindre son travail est déjà contraignant. Si le lieu de travail est
difficilement accessible depuis la gare de destination alors le trajet
multimodal devient une équation impossible. Ce n’est pas le facteur unique mais
c’est certainement le premier facteur qui maintient notre lien de dépendance à
la voiture individuelle et qui cause des pics de circulation sur nos routes et
autoroutes, des embouteillages matin et soir.
24’000 heures par an ou 65 heures quotidiennes de bouchon
sur les autoroutes helvétiques, c’est autant de temps perdu, du temps que nous
ne pouvons consacrer plus utilement à notre travail, à nos loisirs ou à nos
proches, notre famille, notamment le matin et le soir pour les pendulaires.
Trouver des solutions devient dès lors une priorité politique de premier plan pour
assurer simplement notre qualité de vie.
Et si la voiture devenait un moyen de transport public ?
Je ne crois pas qu’il y ait opposition entre moyen
individuel et moyen public de déplacement. La voiture est avant tout une
solution pratique de transport avant d’être un moyen de déplacement individuel.
Depuis plus de cinq ans, la société de taxis Uber a lancé son service UberPOOL dans
les grandes villes du monde, aux Etats-Unis, en France à Paris ou encore dans
des villes de pays émergents et populeux, comme l’Inde. Le concept d’UberPOOL
est simple : vous commandez une course de taxi mais vous partagez votre
véhicule avec d’autres passagers. Lorsque vous embarquez d’autres passagers
occupent déjà les autres sièges. Le taxi s’arrête quelques kilomètres plus loin
pour déposer un passager ou accepter un nouvel occupant et ainsi de suite
jusqu’à votre destination. Gain pour l’utilisateur : un prix de course
réduit puisque le taxi devient collectif et peu de contraintes car le calcul du
trajet se fait intelligemment par des algorithmes sophistiqués pour ne pas
multiplier arrêts et détours. C’est sans doute un très bon exemple qui démontre
que la voiture n’est pas forcément synonyme de transport individuel. En
réalité, la frontière entre déplacements en commun ou individuels sera à
l’avenir de plus en plus perméable.
Une voiture devenue moyen de transport public ? Voilà
incontestablement un véritable changement de paradigme. C’est là que la
multimodalité prend tout son sens : pouvoir enfin résoudre l’équation difficile
des premiers et des derniers kilomètres d’un long trajet, ces kilomètres à
parcourir pour rejoindre une gare principale et les kilomètres depuis la
dernière gare jusqu’à la destination finale… Si un service de voiture nous
amène directement de chez nous à la gare la plus proche et qu’une autre voiture
le fait de la gare à notre lieu de destination, le trajet ville-ville en train
ne devient-il pas enfin des plus attractifs, même pour les nombreux Valaisans
qui habitent loin des centres urbains ?
La voiture autonome va démocratiser le taxi et rendre les trajets en
transports publics possibles
Contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, le
modèle d’affaires d’Uber n’est pas d’employer des chauffeurs de taxi. Qu’ils
soient considérés comme salariés ou indépendants étant encore une autre
question d’ailleurs, totalement périphérique par rapport à leur modèle
d’affaires. Le modèle en question se fonde sur la voiture autonome et donc des taxis
sans chauffeur. C’est dans cette configuration que le système Uber deviendra
rentable et pourra s’imposer. C’est même le seul scénario qui valide une
capitalisation boursière de 60 milliards de dollars, pour une entreprise qui a
repensé le business du taxi, sans posséder un seul véhicule ! Le modèle
dans lequel une voiture vous amène à la gare la plus proche ou vous achemine
depuis la dernière gare vers votre lieu de travail est beaucoup trop onéreux
s’il impose de considérer un chauffeur salarié. Dès lors que le véhicule est
autonome, la plus grosse partie du coût du trajet disparait.
Ainsi, le taxi se
démocratise. Il devient possible de l’utiliser chaque jour pour un budget
accessible au plus grand nombre. Mieux : il rend l’utilisation des
transports publics, notamment les grandes lignes CFF, nettement plus attractive
pour de nombreux usagers pour qui ce n’était pas une solution viable. Le taxi,
fondé d’une part sur la voiture et d’autre part sur le transport individualiste
se mue donc en outil complémentaire de l’offre en transports publics : la
convergence entre la voiture, le bus et le train se matérialise et plus rien ne
les oppose, hors considérations idéologiques.

Habitacle de la voiture autonome Symbioz
imaginée par le constructeur français Renault en 2017
Les chauffeurs de taxi se retrouveront sur la paille car l’Etat a voulu
imposer un système immuable
Dans ce contexte, le combat que se livrent Uber et les
chauffeurs de taxi traditionnels, appuyés par des forces syndicales qui ancrent
leur réflexion dans des schémas de pensée obsolètes et qui réclament un statut
d’employé pour les chauffeurs sonnent totalement comme un anachronisme. Soyons
réalistes : le métier est condamné à se repenser intégralement pour offrir
une réelle nouvelle valeur ajoutée. Car si la seule valeur en termes de service
produite par un chauffeur de taxi est d’acheminer ses passagers d’un point A à
un point B, le métier disparaîtra. Et cela quelle que soient l’opinion des
syndicats de chauffeurs indépendants ou de corporations de compagnies de taxis.
Enfin, je trouve incroyable pour ne pas dire totalement
absurde que nous ayons pu imaginer un système de concessions pour les taxis. Il
s’agit clairement du fruit de décisions politiques irresponsables et à courte
vue. Malheureusement, c’est souvent le cas quand le monde politique, sans
saisir les vrais enjeux, se met à penser et organiser un secteur économique. C’est
cette logique antilibérale qui fera le plus de victimes : des chauffeurs
de taxi qui ont misé sur la valeur de leur concession, théoriquement
revendable, pour fonder leur rente de retraite y ont cru, parce que l’Etat leur
a fait croire que le système était immuable. Or rien n’est immuable dans une
société dont la seule constante est le changement.
Remodeler nos routes et nos villes
Dans une Suisse 2.0 où un service de voitures autonomes accessible
partout et bon marché est parfaitement couplé à une offre de transports publics
efficaces, à quoi bon posséder sa propre voiture ? Ce changement est déjà
en marche : la majorité des jeunes nés après l’an 2000 renoncent
aujourd’hui déjà à passer leur permis de conduire. Et en ce qui concerne la
génération précédente, en 20 ans, le pourcentage de jeunes détenteurs du permis
est passé de 70% à 60% en Suisse, à l’inverse des seniors pour qui détenir un
véhicule est encore associé à l’idée d’autonomie et de liberté, comme le montre
le graphe ci-après.
Possession d’un permis de conduire
selon le sexe et l’âge (source : OFS, ARE, Microrecensement mobilité et
transport MRMT)
En imaginant un service de voitures disponibles devant notre
pas-de-porte et aussi bon marché que la voiture que nous conduisons nous-même
grâce à des véhicules autonomes et donc sans chauffeur, l’intérêt de posséder
un véhicule s’effondre. Il y a donc fort à parier que le nombre total de
véhicules en circulation va fortement décroître les années à venir. Car là
aussi notre société a produit quelque chose d’absurde : un véhicule
destiné à nos déplacements individuels n’est un moyen de déplacement que 2% de
son temps. Le 98% du temps il n’est qu’une source d’encombrement, occupant de
l’espace sur une place de stationnement en attendant sa prochaine course.
Arguments émotionnels mis à part, liés à ce que notre voiture nous renvoie
comme images positives de liberté et d’autonomie, voir de statut social, la
voiture est, la plupart du temps un objet encombrant.
600’000 véhicules autonomes pour remplacer 6 millions de voitures
individuelles ?
Des services de voitures autonomes optimisera les trajets et
le nombre de véhicules. Immobilisé, une voiture ne fait que se déprécier sans
créer de valeur. De tels services feront circuler chaque véhicule pour
plusieurs centaines de milliers de kilomètres par année, en recherchant
l’efficience. Couplé à une offre efficace de transports publics, notamment de trains
rapides pour relier les centres-villes, les distances parcourues sur la route
vont nécessairement reculer. Enfin, des systèmes de covoiturage rendus
possibles par la puissance des algorithmes (comme le service UberPOOL que je
décrivais plus haut) accompagneront nécessairement de tels services et vont permettre
de proposer des offres plus attractives encore, réduisant d’autant l’occupation
de l’espace routier. Il est facilement imaginable dans ce contexte de diviser
le trafic par deux. Plus encore, en optimisant l’utilisation des véhicules et
en évitant les temps de stationnement, c’est-à-dire les moments non rentables,
on peut imaginer un réseau de 600’000 véhicules autonomes remplaçant aisément 6
millions de véhicules individuels pour nos déplacements privés.
La première des conséquences positives est la réduction de
l’encombrement urbain. Car il faut bien l’admettre : après les problèmes
de circulation, le deuxième casse-tête urbanistique de la présence des voitures
est bien l’occupation de l’espace pour en permettre le stationnement. Et si
très justement, au lieu de rester stationné des heures, un véhicule autonome se
déplaçait pour sa prochaine course avec un nouveau client, ce serait autant de
places de stationnement qui ne seront plus nécessaires. Il y a là une
opportunité certaine de remodeler nos paysages urbains.
De nouvelles voies autoroutières inutiles demain ?
Enfin, si la voiture autonome pourrait par hypothèse
permettre de diviser par dix la taille du parc automobile suisse, on peut aussi
douter de l’intérêt de débloquer des milliards de francs d’argent public pour
entreprendre de vastes chantiers onéreux afin d’augmenter le nombre de voies de
nos axes autoroutiers. Devant tant d’incertitude, je suis intimement persuadé
qu’il serait irresponsable de se précipiter dans des chantiers titanesques.
Mais là encore, l’Office fédéral des routes (OFROU) voit juste en proposant des
solutions pragmatiques, très helvétiques à dire vrai : la réaffectation de
la bande d’arrêt d’urgence (BAU) aux heures de pic de circulation en est une.
Elle permet d’absorber cette surcharge de trafic sans engager de vastes
chantiers. Voyons au cours des prochaines années si nos habitudes changent avec
l’arrivée de véhicules autonomes avant de prendre des décisions qui nous
engagent et engagent le contribuable pour plusieurs décennies.

Réaffectation de la bande d’arrêt
d’urgence en 3e voie provisoire lors des pics de circulation :
un pragmatisme helvétique intelligent (source : L’Illustré, 30 septembre
2018)
La voiture autonome amène de véritables opportunités pour nos vallées souvent
mal desservies
Dans nos vallées excentrées et souvent mal desservies,
l’arrivée demain de réseaux de véhicules autonomes constitue une solide
opportunité de repenser notre rapport à la mobilité. Je l’ai exposé plus haut, le
champ des possibles s’élargit en couplant le transport motorisé autonome au
réseau de transports en communs. C’est une chance unique d’apporter un deuxième
souffle, une nouvelle attractivité à nos vallées.
Dépasser les clivages classique entre la gauche et la
droite, entre les partisans et les opposants à la voiture, entre les centre
urbains et les vallées excentrées est plus important que jamais. Le système
politique suisse, fait d’intelligence et de pragmatisme sait y répondre. Soyons
pragmatiques et visionnaires en matière de mobilité. Repensons nos routes, remodelons
nos villes et donnons un souffle nouveau à nos vallées : simplement y
vivre mieux et y vivre bien. Si possible encore longtemps, j’en fais le pari.
Alexandre Luy